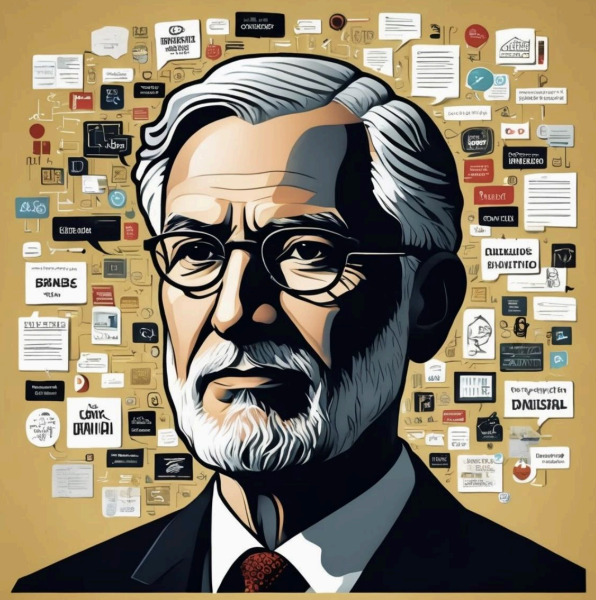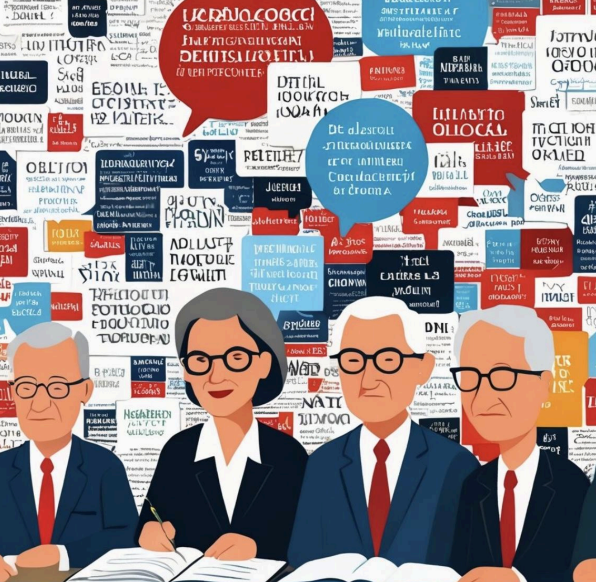Yuri Bezmenov
Yuri Alexandrovich Bezmenov (alias Tomas David Schuman) fut l’un des plus
notoires transfuges du KGB et un analyste majeur des stratégies de
subversion soviétique, dont l’œuvre, longtemps marginalisée, connaît
aujourd’hui un regain d’actualité. Né le 11 décembre 1939 à Mytishchi, près
de Moscou, dans une famille d’officiers supérieurs et d’intellectuels, il grandit
au cœur de l’élite soviétique. Son père, haut gradé de l’Armée rouge, fut
chargé d’inspecter les troupes soviétiques à l’étranger, notamment en
Mongolie et à Cuba.
Dès l’âge de 17 ans, Bezmenov intègre l’Institut des langues orientales de
Moscou, où il se spécialise en hindi, en littérature, en histoire et en musique
indienne. Il y reçoit une formation diplomatique et militaire, incluant la
cartographie stratégique et l’interrogatoire de prisonniers, préparant ainsi les
futurs agents à des missions d’influence à l’étranger. Diplômé en 1963, il part
en Inde comme traducteur et responsable des relations publiques pour les
projets de raffineries soviétiques. Il y observe de près les méthodes de
pénétration culturelle et politique du bloc de l’Est.
En 1965, Bezmenov rejoint la Novosti Press Agency (APN), vitrine médiatique
du KGB. Selon ses propres déclarations, près de 75 % du personnel de
Novosti était composé d’officiers du KGB ou de collaborateurs directs. Il y
apprend l’art de la désinformation : rédaction d’articles, organisation de
voyages pour influenceurs étrangers, manipulation des médias et infiltration
des milieux intellectuels. En 1969, il retourne en Inde comme attaché de
presse à l’ambassade soviétique, poursuivant ses activités de propagande et
d’espionnage.
C’est lors de ce second séjour à New Delhi qu’il prend conscience de la
corruption, de la brutalité et de l’inefficacité du système soviétique. Il
commence alors à planifier minutieusement sa défection. En 1970, profitant
d’un voyage touristique, il se déguise en hippie, échappe à la surveillance du
KGB et trouve refuge auprès des autorités américaines, avant d’être exfiltré
vers le Canada dans le cadre d’un accord entre les services de
renseignement américains et canadiens.
Installé à Montréal sous le nom de Tomas David Schuman, il devient
journaliste, puis conférencier et auteur. Il collabore avec les médias
canadiens, mais son identité est rapidement révélée par la presse soviétique,
le privant de la protection des services occidentaux et l’exposant à la menace
d’agents soviétiques. Malgré une vie personnelle marquée par la solitude et la
précarité, il s’engage dans une vaste campagne de sensibilisation sur les
mécanismes de la subversion idéologique.
Bezmenov publie plusieurs ouvrages, dont Love Letter to America, No Novosti
Is Good News, World Thought Police et Black Is Beautiful, Communism Is
Not. Il donne de nombreuses conférences, notamment aux États-Unis, et
accorde en 1984 une interview remarquée à G. Edward Griffin, qui sera
redécouverte et massivement diffusée sur Internet à partir de 2013, lui
conférant une célébrité posthume inattendue.
Son analyse la plus marquante concerne la stratégie de subversion
idéologique du KGB, qu’il décrit comme un processus lent et méthodique
visant à déstabiliser les sociétés occidentales sans recourir à la force armée.
Selon Bezmenov, 85 % des ressources du KGB étaient consacrées à la
guerre psychologique, à la désinformation et à la manipulation, contre
seulement 15 % à l’espionnage traditionnel. Il distingue quatre étapes :
- Démoralisation : sur 15 à 20 ans, destruction des valeurs, de la
confiance dans les institutions, infiltration des médias, de l’éducation et
des élites culturelles. - Déstabilisation : sur 2 à 5 ans, création de crises économiques,
politiques et sociales, exacerbation des divisions internes. - Crise : point de rupture, souvent marqué par des violences, des révoltes
ou un effondrement des structures étatiques. - Normalisation : instauration d’un nouveau régime autoritaire sous
prétexte de rétablir l’ordre, consolidant l’influence étrangère.
Bezmenov insiste sur le fait que la subversion ne vise pas à convertir, mais à
désorienter, à rendre la société incapable de discerner le vrai du faux, et donc
vulnérable à toute forme de manipulation. Il met en garde contre la naïveté
des élites occidentales, qu’il accuse d’être les « idiots utiles » du système
soviétique, et contre le risque de voir la démocratie minée de l’intérieur par
l’idéologie et la désinformation.
Malgré la relative indifférence de son vivant — il fut souvent perçu comme
alarmiste, voire marginalisé par les services occidentaux eux-mêmes —,
Bezmenov est aujourd’hui abondamment cité dans les débats sur la
désinformation, la polarisation politique et la guerre cognitive. Ses
interventions ont été reprises dans des documentaires, des analyses
universitaires, et même dans la culture populaire, comme le jeu vidéo Call of
Duty.
Yuri Bezmenov meurt à Montréal le 5 janvier 1993, dans l’anonymat et la
précarité. Son héritage, longtemps ignoré, s’impose désormais comme une
référence incontournable pour comprendre les dynamiques contemporaines
de manipulation des masses, la fragilité des sociétés ouvertes et la puissance
des stratégies de subversion idéologique héritées de la guerre froide.
Paul-Michel Manandise